|
L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE ET LA SCIENCE
DE L'ÉDUCATION RÉPUBLICAINE

par Jean-Louis GUIGNARD
(Troisième partie)
L ’histoire de la Révolution française a été si mystifiée que les simples
« droits démocratiques » et la « liberté » dont jouissent aujourd’hui les
citoyens de France et des autres nations capitalistes européennes passent pour
la principale conquête de cette période révolutionnaire, une conquête que nous
devrions aux Jacobins, aux Sans-culottes et à la prise de la Bastille. Il est
grand temps de démonter la supercherie et de jeter aux poubelles de l’histoire
ces instruments de la politique britannique, les Mirabeau, Danton et autres
Marat tenus aujourd’hui encore pour les grandes figures de la Révolution
française. II est surtout grand temps que les hommes qui ont, eux, dirigé
l’authentique Révolution française, relégués à un rang secondaire de l’histoire
ou enfouis plus profondément sous des calomnies, soient connus du grand public
pour la contribution cruciale qu’ils ont faite au développement de la
civilisation humaine.
Le texte qui
suit a été initialement publié dans La science de l’éducation républicaine, Campaigner Publications, 1980
Le Journal de l’École polytechnique : faire avancer
les lumières générales
« L’objet de ce journal, publié en vertu d’un arrêté des trois Comités de
la Convention qui surveillent l’École centrale des travaux publics, se trouve
dans les motifs exprimés au considérant de l’arrêté de ces Comités, savoir : de
justifier l’emploi des moyens que la République fournit pour l’instruction des
élèves ; de les encourager, ainsi que ceux qui concourent à leur enseignement,
par la publicité donnée à leurs travaux et à leurs soins ; de faire prendre aux
études une direction qui tende sans cesse à les perfectionner ; d’offrir un modèle
propre à guider d’autres établissements d’instruction ; enfin de répandre des
connaissances très-utiles aux arts ou aux sciences, et de provoquer l’extension
de leur domaine par des découvertes nouvelles ou des applications heureuses
(...).
Chaque mois, il paraîtra un cahier de ce bulletin ; on y trouvera des
comptes rendus, rédigés ordinairement par les instituteurs, chacun pour la
partie qui le concerne. Ces comptes rendus donneront, en chaque genre, la
notice du travail fait dans le mois. Les découvertes et les solutions élégantes
de problèmes, fournies, soit par les instituteurs, soit par les élèves, y
seront également insérées : ce cahier en présentera quelques exemples
intéressants. Les instituteurs et tous les agents attachés à l’école pourront
aussi faire paraître des mémoires relatifs aux sciences ou aux arts, quel qu’en
soit l’objet ; il suffira qu’ils contiennent des vérités utiles à répandre, ou
des nouveautés propres à faire avancer les lumières générales (…).
Par rapport au cours de physique, on a l’intention que les expériences
qui s’y feront en présence des élèves, aient pour objet, autant qu’il sera
possible, ou de constater quelque phénomène nouveau, ou de redresser des
erreurs dans les explications des faits déjà connus. Dans cette vue, on formera
le projet d’une série d’expériences les plus intéressantes à tenter ; et la
publicité qui leur sera donnée, à mesure qu’elles seront exécutées, contribuera
efficacement au progrès de la science (...).
Si l’on se représente un moment par la pensée quatre cents jeunes gens,
choisis par leurs premières connaissances mathématiques, rassemblés sur un
amphithéâtre, écoutant les instituteurs qui viennent successivement, dans
l’espace de trois mois, leur présenter le magnifique tableau des sciences et
des arts dont ils apprécieront en détail les diverses parties pendant leur
séjour à l’école ; si l’on voit ensuite ces élèves, se distribuant par brigades
de vingt, dans des salles où ils travaillent six heures chaque jour, tracer les
nombreux objets de la géométrie descriptive qu’on leur enseigne ; si de là, on
les suit dans un local orné de tout ce qui peut embellir leur imagination et
former leur goût pour le dessin, sur lequel ils s’exercent pendant les trois
dernières heures du jour, en alternant par divisions pour l’étude de l’analyse
pendant le même temps ; si enfin on les retrouve, deux jours de chaque décade,
dans des Laboratoires de chimie, manipulant eux-mêmes, après avoir reçu la
leçon de leur instituteur, et s’y délassant, par l’exercice du corps et
l’attrait de tant d’objets curieux, de l’application donnée, les autres jours,
aux objets plus sérieux des mathématiques ; quel intéressant spectacle ! Qui ne
se sentira heureux et ne se glorifiera pas d’avoir contribué à l’instruction, aux
premiers essais, aux progrès, d’une jeunesse si chère à la République par
l’espoir qu’elle lui donne ! (…)
Il reste maintenant à annoncer en peu de mots les modifications que l’on
croit devoir introduire pour l’avenir dans le plan du Journal (...).
Les instituteurs, les agents de l’école, les élèves sont invités à
fournir des mémoires sur les sciences et les arts, soit qu’il s’agisse de
travail fait dans l’établissement, soit de recherches tirées d’ailleurs.
Les mémoires de même genre qui seraient adressés par des savants en
correspondance avec l’école, seraient également accueillis (...).
Et de temps en temps, l’on y
joindra l’exposition de la situation de l’école et de son régime.
La partie historique de sa formation et de ses progrès, la description
des collections de machines, modèles ou dessins qu’elle renferme ; l’annonce de
ce qu’il y aura d’heureux, de nouveau, de plus expéditif dans les méthodes
d’enseignement ; des détails sur les opérations, sur la qualité du travail
exécuté, qui en fassent concevoir la possibilité, qui mettent à portée d’en
faire ailleurs la répétition ; des vues sur les qualités que l’on doit
s’attacher à former, à développer, à porter au plus haut degré dans les élèves,
pour les rendre vraiment propres aux différents services publics, et tant
d’autres considérations importantes à tirer d’un sujet si fécond, nous semblent
dignes d’être offertes au public.
Nous ferons tous nos efforts pour
remplir son attente, ainsi que les intentions du Gouvernement, en nous attachant
sans cesse à perfectionner l’institution confiée à nos soins, et en contribuant
de tous nos moyens à la communication des lumières et à l’accroissement de
l’instruction générale ».
Journal de l’École polytechnique, avant-propos, 1795
Le Journal de l’École polytechnique fut conçu comme l’instrument d’une
importante propagande pédagogique et scientifique (voir encart ci-dessus « Le
Journal de l’École polytechnique : Faire avancer les lumières générales »). Son
but était de présenter de manière pédagogique certains des aspects les plus
importants des travaux réalisés à l’École, à la fois dans le cadre des cours et
des recherches faites par les élèves, de sorte que d’autres établissements
d’enseignement à travers le pays et au-delà des frontières soient en mesure de
répliquer immédiatement ces travaux. Comme l’expliquent les rédacteurs du
Journal, il s’agissait dans un même temps d’encourager les applications
pratiques sur lesquelles pouvaient déboucher les découvertes scientifiques
ainsi largement diffusées. L’École polytechnique était conçue comme un modèle,
un point de référence pour toutes les couches de la population engagées dans le
processus de développement économique et la formation d’une force de travail
qualifiée ; tout le matériau - méthodes pédagogiques, solutions imaginées par
les professeurs et les élèves aux différents problèmes scientifiques et
techniques, découvertes, expériences, instruments, etc. - qui pouvait
contribuer à développer la connaissance et la pratique humaines dans toute la population
était décrit, expliqué dans le Journal. Loin d’être considérés par les
fondateurs de l’École comme une élite de grands prêtres « détenant » la science
et coupée de la population, les jeunes polytechniciens étaient explicitement
encouragés à assumer directement la responsabilité de propager directement la
connaissance scientifique dans toute la population. C’était là la mission
morale qui leur était fondamentalement impartie. Car, en effet, « sans un
admirable dévouement au progrès de leurs condisciples », les membres de toute
élite républicaine dégénèrent et se condamnent à ne plus être des républicains,
mais seulement des « élitistes ».
L’organisation initiale de l’École comportait un autre aspect-clé qui
était le fait de l’engagement républicain exemplaire de Monge et de Carnot.
Tous deux représentaient de rares cas de « plébéiens » qui avaient réussi à se
faire admettre à l’école militaire de Mézières ; tous deux ne parvinrent à leur
degré de compétence scientifique et militaire qu’au prix d’une longue et amère
histoire de harcèlement et de luttes humiliantes avec le système de l’Ancien
régime où les carrières militaires et scientifiques étaient le privilège de la
noblesse. Ceci n’était pas compatible avec le développement d’une nation de
citoyens républicains. Les élèves de l’École polytechnique, qui étaient admis
pour la première fois dans une institution incarnant le plus haut niveau
d’enseignement sans distinction d’origine sociale, devaient être entièrement
pris en charge par l’Etat durant leurs trois années d’études. C’était le moyen
de donner au plus grand nombre de citoyens, quelle que soit leur origine, la
possibilité d’accéder à des qualifications scientifiques et techniques. De
surcroît, les fondateurs de l’École avaient prévu que les élèves vivraient en
dehors de l’établissement, dans des familles républicaines de la capitale, où
ils trouveraient une atmosphère encourageante pour leurs études, un soutien
moral et des conditions matérielles adéquates. La population pouvait ainsi
prendre conscience directement de l’importance de ces jeunes cadres qui
allaient contribuer à développer la République.
Avant la militarisation de l’École, la discipline interne était
quasiment assurée par les chefs de brigades qui jouissaient naturellement d’une
grande autorité morale.
Telle qu’elle fut originellement conçue par Monge, Carnot, Prieur et
leurs proches collaborateurs, l’École polytechnique vécut moins de dix ans,
malgré les âpres efforts qui furent déployés pour la sauvegarder. Les
opérations hostiles à cette institution commencèrent dès 1795, une année
seulement après sa création. La Convention tenta à plusieurs reprises de « purger
» de l’École les éléments prétendument « anticiviques » et antirépublicains,
accusés de se livrer à des activités pro-royalistes en dehors des murs de
l’École. Il s’est sûrement trouvé un certain nombre de polytechniciens pour
prendre part aux « chasses aux Jacobins » et autres agissements des gangs de
Muscadins mais une telle « purge » n’aurait pas manqué d’être des plus
préjudiciables au fonctionnement de l’École, et c’était bien là l’effet
escompté. Sous le Directoire, sommé une nouvelle fois de procéder à la
répression des prétendus activistes, le conseil de l’École refusa tout net de
s’exécuter, conscient que la manœuvre était avant tout dirigée contre l’École
toute entière. Par ailleurs, le Comité des fortifications, avec l’aide du
Ministre de l’intérieur Baraillon, tenta maintes fois
de trouver des prétextes justifiant des mesures répressives à l’encontre de
l’École, arguant que celle-ci était trop « privilégiée » par rapport aux autres
écoles d’ingénieurs et appelant à sa réorganisation sur un modèle militaire -
réorganisation que Napoléon allait imposer en 1804. Plus insidieuse mais non
moins dangereuse fut la subversion qui s’exerçât de l’intérieur de la part des
réductionnistes tels Laplace, le mathématicien, qui réclamait une orientation
plus « théorique » des études accusées d’accorder trop de place aux activités
pratiques et concrètes !
Malgré toute l’affection qu’il avait pour Napoléon, Monge combattit
avec acharnement la dénaturation que celui-ci fit subir à l’École
polytechnique. La décision de Napoléon d’en revenir au système de l’Ancien
régime en ne recrutant à l’École que des élèves originaires de familles riches
fut particulièrement pénible pour un Monge qui, depuis son retour d’Egypte en
1799, avait été jusqu’à donner son salaire de professeur et sa pension de
retraite pour aider les élèves les plus déshérités. Les fonds publics alloués à
l’École avaient déjà été drastiquement réduits en 1799, malgré l’opposition
virulente de Prieur.
Le décret de Napoléon en date de 1804 imposant une « discipline
militaire » à l’École fut rejeté comme étant « désastreux » par Monge. Les
élèves se virent ensuite contraints de payer une pension annuelle très élevée.
Le contenu de l’enseignement se détériora rapidement, prenant une direction que
Pinet décrit comme « fondamentalement » opposée aux idées des fondateurs de
l’École. Certains cours furent supprimés, notamment ceux d’ingénierie civile -
décision à laquelle Monge s’opposa particulièrement. Le cours spécial de génie
civil fut complètement éliminé en 1807, tandis que les « arts académiques »
faisaient leur entrée en force avec la création d’une chaire de grammaire et de
belles-lettres.
« Moins pour la science elle-même que pour les
services qu’elle rend à l’autre » (1)
Avant d’entrer dans certains des aspects-clé de l’enseignement que
reçurent les premiers Polytechniciens, il est important de voir comment le
projet de l’École polytechnique, dans son principe essentiel, fut une
expression directe de la pensée néo-platonicienne, la prolongation de l’œuvre
réalisée par les réseaux humanistes que Leibniz et Descartes façonnèrent au
XVIIe siècle et qui avait trouvé sa forme pratique la plus avancée dans le «
Système américain ». En d’autres termes, l’École était aussi l’œuvre des grands
Oratoriens, d’une part, et de Franklin, de l’autre.
Franklin, le « Sage de Boston », appartenait à l’Académie royale des
sciences en vertu de ses découvertes sur l’électricité, et il participa
régulièrement aux sessions de l’Académie durant les quatre années qu’il passa à
Paris en tant qu’Ambassadeur de la République américaine. Le « Prométhée
moderne », comme on l’appelait dans les milieux humanistes français, jouissait
d’un prestige considérable. Il avait établi ses quartiers généraux à Passy, qui
n’était alors qu’un faubourg parisien et qui allait très vite devenir son «
Versailles de la philosophie », d’où il se livra à d’intenses activités
organisatrices au nom de l’Idée de progrès qui animait alors la République
américaine. C’est ainsi qu’il organisa au sein de la franc-maçonnerie - qui
regroupait certains des plus grands esprits du pays - une faction contre l’influence
britannique du Duc d’Orléans. En 1779, Franklin prit la tête de la célèbre Loge
des Neuf Sœurs à Paris, année même où Monge rejoignit les réseaux maçonniques à
Mézières. Sous l’impulsion de Franklin, la Loge connut un ·essor considérable
les deux années qui suivirent, notamment dans le domaine de l’éducation. Comme
Carnot l’explique dans son Rapport à l’Empereur sur l’Instruction (voir encart
« Le grand art de
l’économie politique » ci-dessous), l’effort des Pères fondateurs de l’Amérique pour promouvoir
l’instruction était considéré comme exemplaire. Ce fut la Loge des Neuf Sœurs,
par exemple, qui parraina le premier collège laïc public, suivant un plan
suggéré directement par Franklin où l’accent était mis sur l’enseignement
scientifique. Ce collège devint plus tard le Lycée de Paris, où Monge enseigna
pendant près de deux ans.
Lorsqu’il organisa l’École plus tard, Monge se servit de son expérience
à Mézières et des méthodes employées à l’École de Schemnitz,
dont Mézières s’était inspirée, qui avait été fondée en Hongrie par
Marie-Thérèse. Son docteur, Ingenhousz, était un
vieil ami de Franklin de même qu’un ami de Monge. Schemnitz
possédait un laboratoire de chimie célèbre, que Monge avait reproduit à
Mézières.
Monge et Carnot avaient d’autre part été tous les deux éduqués chez les
Oratoriens, et ceci, comme nous allons le voir, devait jouer un rôle essentiel
dans leurs accomplissements futurs.
La Congrégation de l’Oratoire de Notre Seigneur Jésus-Christ en France
avait été fondée en 1611 par le Cardinal Pierre de Bérulle, un proche ami de
Richelieu, et plus tard, de Descartes, en tant qu’émanation directe du grand
projet de réforme éducative d’Henri IV dont celui-ci avait saisi une commission
qui y travailla de 1595 à 1600. En tant que congrégation religieuse, l’Ordre de
l’Oratoire fut approuvé par le Pape Paul V en 1613 et encouragé à développer
une vocation éducative pour contrer l’Ordre rival des Jésuites.

Pierre de Bérulle
Alors que les Jésuites étaient principalement implantés dans les
grandes villes et exerçaient leur influence sur les couches les plus riches de
la population, les Oratoriens établirent leurs collèges dans les petites villes
et ouvrirent leurs portes aux couches plus défavorisées. Les Pères oratoriens
engageaient même souvent leur fortune personnelle pour aider les élèves les
plus pauvres à suivre des études dans leurs collèges. En dépit des divers
troubles que connut l’Oratoire durant l’agitation politique qui marqua la
seconde moitié du XVIIe siècle - suite à la révocation de l’Edit de Nantes par
Louis XIV, et surtout après 1663, date à laquelle les travaux de Descartes
furent mis à l’index et l’enseignement de la théorie cartésienne fut réprimée
en France - l’Ordre de l’Oratoire réussit toujours à maintenir en son sein un
noyau influent de Platoniciens convaincus, dont les plus éminents furent les
philosophes-savants Lamy, le chef de file du parti cartésien en Anjou, Pelaud,
qui succéda à Lamy lorsque celui-ci fut exilé, et Malebranche qui introduisit
Leibniz dans l’enseignement oratorien. Cette élite livra une bataille
continuelle contre les Thomistes au sein de l’Oratoire et contre les
Aristotéliciens incarnés par les Jésuites, en dehors. Les Jésuites, fervents
défenseurs du système aristotélicien, recommandaient officiellement à tous
leurs professeurs de « suivre l’aristotélisme, non seulement en logique et en
métaphysique, mais en philosophie naturelle ». Sous les pressions de l’État,
des mesures répressives furent maintes fois prises à l’encontre des disciples
de Descartes dans l’Oratoire, qui suscitèrent de très vives réactions. La lutte
opposait alors ouvertement les partisans de l’aristotélisme et ceux du
platonisme, Descartes étant considéré par ses nombreux défenseurs dans
l’Oratoire comme l’héritier direct de Platon. Dans des collèges oratoriens
comme ceux d’Angers et de Saumur, la plupart des enseignants, fortement acquis
aux idées de Descartes, refusèrent de ne plus enseigner ses thèses, ce qui
valut à Lamy d’être exilé en 1676. Richelieu et Mazarin appelèrent auprès d’eux
d’éminents Oratoriens dans la conduite des affaires de l’Etat, tout en maintenant
les Jésuites à distance - situation qui fut renversée par Louis XIV à sa
majorité. Les Oratoriens retrouvèrent leur influence politique après
l’expulsion des Jésuites hors de France en 1764 à l’instigation de Guyton de Morveau, mais furent
éliminés avec toutes les autres congrégations religieuses en 1792 - mesure
qu’un de leurs historiens a qualifiée de « violation des Droits de l’Homme »,
car avec eux, c’était la meilleure éducation populaire qui disparaissait.
L’un des grands principes de l’éducation oratorienne était que l’élève
devait être lui-même un éducateur pour mieux apprendre. La fonction enseignante
exercée par l’élève auprès de ses compagnons plus jeunes était considérée comme
une source de bienfaits tel « le plaisir de communiquer ce que l’on sait, le fait d’avoir un but social
et concret à atteindre, la nécessité d’apprendre et de se perfectionner pour
mieux enseigner », comme le
déclarait le Père Houbigant en 1720. C’est pourquoi
les Oratoriens avaient très vite établi le système des régents, c’est-à-dire
des jeunes instructeurs, sur lequel Monge, qui enseigna lui-même la physique à
l’âge de 16 ans au collège oratorien de Beaune, modela ses « chefs de brigades
» à l’École polytechnique. Après quelques années d’études, les élèves des
collèges oratoriens étaient vivement encouragés à devenir des régents, après
quoi les régents avaient le choix entre devenir prêtres, acquérir un véritable
poste d’enseignant ou quitter la congrégation pour des activités séculaires si
tel était leur désir. En fait, la majorité du corps enseignant de l’Ordre était
formée de jeunes régents, et c’est parmi eux que la théorie de Descartes trouva
ses adeptes les plus convaincus. En 1684, alors qu’il se trouvait en exil à
Grenoble, Lamy écrivit un livre polémique exposant la méthode oratorienne dans
ce qu’elle avait de meilleur. Ce livre, intitulé Entretiens sur les sciences dans lesquels outre la
méthode d’étudier, on apprend comment l’on doit se servir des sciences pour se
faire l’esprit juste et le cœur droit, et accompagné de Réflexions sur l’art
noétique, se présentait sous forme d’un dialogue entre
Théodose (Lamy) et Aminte (incarnant des amis de Lamy
restés à Angers). Le thème central en est une attaque de Théodose contre la
manière aristotélicienne dont la philosophie était alors couramment enseignée,
sous forme de commentaires dictés sur des idées philosophiques. Théodose
propose au contraire d’utiliser directement comme matériau d’une étude de la
philosophie, les expériences et découvertes les plus importantes du siècle en
cours, dans le domaine de la physique, des mathématiques, de la chimie, de
l’anatomie, et de lire publiquement des textes originaux. Théodose suggère que
les traités ainsi choisis soient ensuite discutés en public. Ce que Lamy
voulait dire par là, c’est que la forme du dialogue platonicien devait jouer un
rôle essentiel dans l’enseignement des Oratoriens. Et dans une certaine mesure,
c’était déjà le cas : les cours se terminaient toujours sur une discussion
animée entre le maître et les élèves et la tâche des régents était en fait
d’organiser des dialogues platoniciens avec leurs jeunes camarades. Cette idée
fondamentale de Lamy, à savoir que « pour bien comprendre, il faut enseigner » fut reprise plus tard par Monge, dont les cours à l’École polytechnique,
et auparavant à l’École normale, restent célèbres pour l’enthousiasme qu’ils
suscitaient parmi les élèves avec lesquels Monge dialoguait fréquemment et dont
un bon nombre d’entre eux devinrent plus tard de grands éducateurs (2).
Ce que Lamy voulait également dire c’est que l’étude de la science et
de la philosophie est une seule et même chose, que la connaissance
philosophique et scientifique s’acquiert par l’étude du processus de la
science, en se concentrant sur les dernières découvertes de l’époque. Le lien
entre la science et la philosophie était considéré comme si étroit par les
Oratoriens qu’ils n’enseignaient pas la science comme une catégorie séparée.

Lamy
L’enseignement scientifique était généralement assuré par le professeur
de philosophie. (Notons le cas typique de ce Père oratorien qui enseignait la
philosophie et qui construisit un aérostat à Condom en 1785). Les Oratoriens
s’intéressaient tout particulièrement aux découvertes de leurs contemporains
dans le domaine de l’électricité et du calcul différentiel et intégral, notamment à celles de Leibniz, dans le
cadre d’un effort dirigé vers le développement des sciences exactes à l’opposé
de l’enseignement scientifique alors dispensé par
l’université de Paris, qu’ils accusaient de « subjuguer l’esprit à la règle des
syllogismes » (3). Leur Ordre fut lui-même un véritable foyer scientifique,
d’où furent issues plusieurs générations de grands savants. Le premier
professeur d’hydrographie en France, Guillaume Denis, fut un Oratorien qui
ouvrit une chaire d’hydrographie au collège de Dieppe en1665, le premier
collège oratorien établi en France, en 1616. C’est aussi là que fut ouverte la
première chaire de mathématiques et que furent étudiées les sections coniques
de Pascal en géométrie. L’hydrographie était alors une science naissante,
encouragée par Colbert qui faisait du développement des canaux et des machines
hydrauliques l’un des piliers de sa politique d’expansion industrielle.
L’hydrodynamique, comme elle fut appelée plus tard, mena à des découvertes qui
comptent parmi les plus importantes de la physique moderne et a été le vecteur
de l’épistémologie leibnizienne, depuis Leibniz et ses collaborateurs les
Bernoulli, jusqu’à Monge et de Broglie. Chez les Oratoriens, l’enseignement de
la science faisait généralement partie intégrante de celui de l’histoire, l’une de leurs
innovations les plus importantes. Les Oratoriens avaient fortement réagi contre
l’enseignement de l’histoire alors courant en France, qui se limitait à
l’histoire d’Athènes et de Rome et à ce qu’ils rejetaient comme la « science
vide des commentateur ». Ils jugeaient comme beaucoup plus utile d’étudier les
faits historiques se rapportant à l’histoire de la France chrétienne. Aux héros
de la Rome antique et de la mythologie gréco-latine, culture qu’ils dénonçaient
comme « imprégnée de paganisme » (4), ils contreposèrent
les grands bâtisseurs de la nation française : Charlemagne, Louis XI, Jeanne
d’Arc, Henri IV. La première leçon de cette nouvelle conception de l’histoire,
l’histoire de France, fut donnée en 1634, en français, car les Oratoriens
s’appliquaient dans un même temps à promouvoir l’étude du français comme langue
vivante, exprimant l’âme du processus qui avait engendré la nation. Tous leurs
cours étaient en fait donnés en français, contrairement aux Jésuites qui
n’employaient que le latin. Et c’est à la lumière de l’histoire de France que
les Oratoriens faisaient ressortir le rôle moteur du développement des sciences
et des techniques.
Parmi les réalisations des Oratoriens en matière de pédagogie les plus
susceptibles de favoriser le rayonnement de la connaissance dans toute la
population, leur but premier, nous devons mentionner celle des « exercices
publics » où les élèves se livraient à des expériences scientifiques de
physique et autres en présence de leur famille, de leurs amis et de la
population locale, conviés pour l’occasion. Les collèges oratoriens étaient
généralement équipés de cabinets de physique et de nombreux instruments
scientifiques, et les élèves encouragés à effectuer des manipulations par
eux-mêmes. Aux régents l’on demandait d’écrire des pièces de théâtre sur le
thème du combat intérieur que l’homme voulant atteindre à la véritable dignité
doit livrer aux instincts et passions qui l’enchaînent à l’âme de bronze et
d’argent décrites par Platon, pour tendre vers la raison de l’âme d’or, qui
obéit, elle, à la loi supérieure de la Liberté Nécessité - thème qui trouva
toute son expression politique dans les travaux du grand poète et dramaturge
allemand Schiller dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ces pièces étaient
représentées publiquement dans les différents collèges fréquentés par les
régents ; chaque année, en effet, les régents changeaient de collège, afin que
les idées nouvelles dont ils étaient porteurs en termes de découvertes et de
méthodes pédagogiques, circulent rapidement dans tout le pays.
L’idée fondamentale sur laquelle reposait l’enseignement oratorien
était que ce n’est pas la somme des connaissances particulières acquises qui
est importante, mais le processus de perfection de l’esprit dont l’étude de la
science est le médiateur, la faculté de « bien penser ». Enseigner, pour les
Oratoriens, signifiait « se faire ouvrier de lumière » ; la science était le moyen de créer de vrais chrétiens, des hommes
consciemment engagés dans le perfectionnement de leur esprit. « Notre esprit n’est pas fait pour l’érudition
», disait Lamy, « mais l’érudition pour l’esprit, c’est-à-dire qu’on doit en
user pour le régler et le perfectionner ». Répudiant les connaissances superficielles, Lamy ajoutait : « Il
faut que les études se changent en notre substance », il faut ramener tout à la
connaissance non des hommes mais de « l’homme universel ».
Fin de la troisième partie (sur cinq). Quatrième partie : « La géométrie
et la philosophie de la science ».
(1) C’était la devise de la Congrégation des Oratoriens.
(2) L’efficacité de la méthode oratorienne ressort clairement de cette
anecdote rapportée par Paul Lallemand dans son livre Essai sur l’histoire de
l’éducation dans l’ancien Oratoire de France (1888) : « les Protestants
Interdisaient à leurs élèves d’aller voir le Père oratorien André Martin,
auteur d’un livre sur la philosophie de Saint Augustin car ils ne manquaient
pas d’en revenir convertis au catholicisme ! »
(3) Paul Lallemand, ibid.
(4) « Les hommes de la Révolution, fascinés par les héros de la Rome
antique, s’ils avaient guidé leurs délibérations sur une connaissance
approfondie du passé, discernant à la lumière de l’expérience les besoins
nouveaux que réclamaient les idées et les mœurs (...), pas tant de sang aurait
coulé », remarque Paul Lallemand dans son livre.
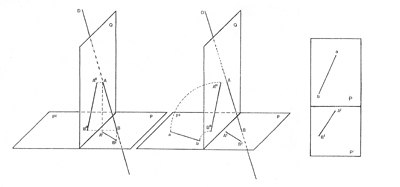
|

